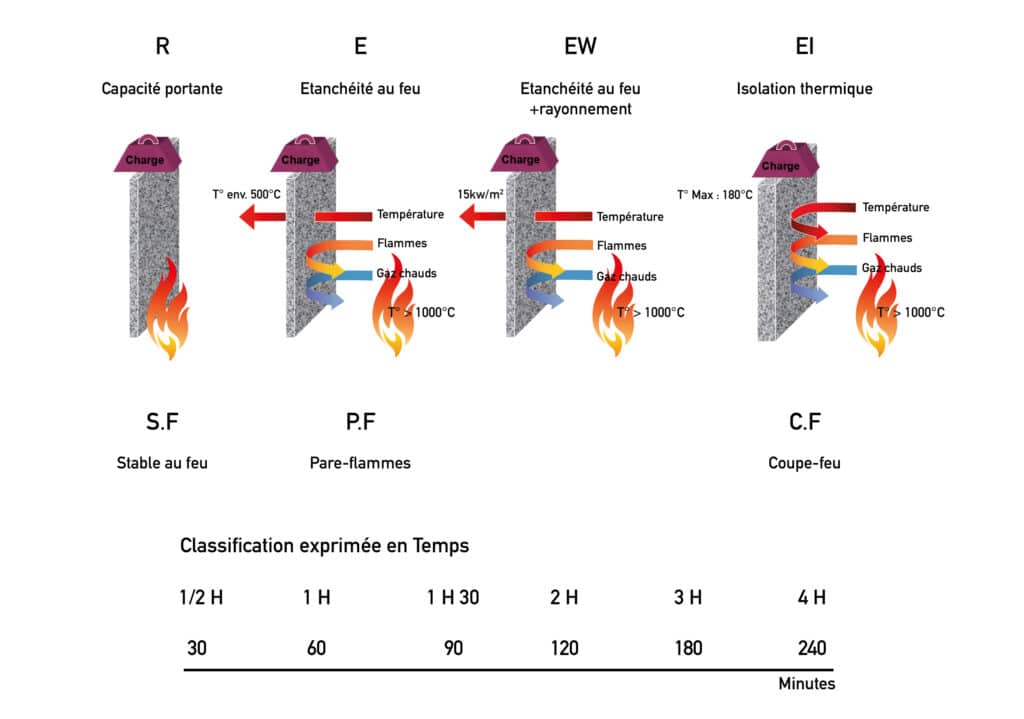La nacelle élévatrice est couramment utilisée pour l’élagage, les réparations et les opérations de maintenance à une hauteur que l’échelle ne permet pas d’atteindre. Par nature, cet équipement protège le travailleur en hauteur, à condition de respecter les règles d’utilisation.
Pour garantir la sécurité de ces appareils, il est également important d’effectuer une VGP (Vérification Générale Périodique) des nacelles tous les trois ou six mois en fonction du type d’appareil.
La VGP de nacelle concerne toutes les catégories de nacelle et comprend différents points de contrôle ainsi que des essais de fonctionnement.
VGP de nacelle : connaître les différentes catégories
Les nacelles sont divisées en deux groupes : les nacelles ciseaux et les nacelles à bras, et en trois catégories :
- Les nacelles de catégorie 1 dont le déplacement n’est autorisé qu’en position de transport,
- Les nacelles de catégorie 2 dont le déplacement avec la plateforme de travail en position haute doit être piloté par un système situé sur le châssis,
- Les nacelles de catégorie 3 dont le déplacement avec la plateforme de travail en position haute peut être piloté par un système situé sur le châssis ou sur la plateforme.
Quels sont les différents contrôles réalisés au cours d’une VGP nacelle ?
Lors d’une vérification de nacelle, différents contrôles sont effectués pendant la VGP. Puis s’ensuivent des essais de fonctionnement.
Les différents points contrôlés lors de la VGP nacelle
Au cours de l’examen de la VGP, tous les éléments composant la nacelle sont vérifiés (état, serrage, présence des clapets de sécurité etc.) :
- La charpente, le châssis et les roues,
- Le moteur, la batterie et la pompe,
- Les axes, les freins et les actionneurs hydrauliques,
- Les connections électriques,
- Le poste de commande et la direction,
- La présence de la signalétique.
Les différents contrôles sont suivis d’essais de fonctionnement. Ceux-ci permettent de garantir une utilisation normale de l’appareil dans le respect des vitesses définies par le constructeur et sans à-coup.
Les vérifications de mise et remise en service
Les VGP de nacelle sont également obligatoires lors de la mise en service ou de la remise en service de l’appareil, quelle que soit la durée de son interruption.
Lors de ces contrôles, les examens portent sur l’adéquation, l’état de conservation et le fonctionnement de l’appareil. Une épreuve statique et une épreuve dynamique sont également réalisées à cette occasion.
VGP nacelle : qui effectue les contrôles et quand ?
La fréquence des VGP de nacelle diffère suivant le type d’équipement. Les nacelles élévatrices doivent être vérifiées tous les six mois tandis que les appareils mus par la force humaine doivent faire l’objet d’une VGP tous les trois mois.
Ce contrôle peut être effectué par un collaborateur qualifié de l’entreprise, le fournisseur de l’appareil ou un organisme agréé spécialisé dans le conseil en maîtrise des risques. Le vérificateur doit disposer du manuel de la nacelle, de son carnet de maintenance, de son certificat de conformité et des rapports de vérification précédemment établis.
Quel est le prix d’un contrôle VGP de nacelle ?
Le prix d’un contrôle, ou VGP de nacelle, est compris entre une centaine d’euros et 170 € pour une vérification périodique.
Pour une remise en service de l’appareil, il faut compter un supplément d’environ 30 €.
À l’instar des VGP de nacelle, il existe des VGP pour les ponts roulants ou encore des VGP pour les chariots élévateurs.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre article dédié à la certification d’un appareil de levage.

Questions fréquentes sur les VGP nacelles
Selon le type de nacelle, la VGP doit être réalisée tous les trois ou six mois.
Un collaborateur qualifié de l’entreprise, le fournisseur de l’appareil ou un organisme agréé spécialisé dans le conseil en maîtrise des risques peut réaliser ce contrôle.