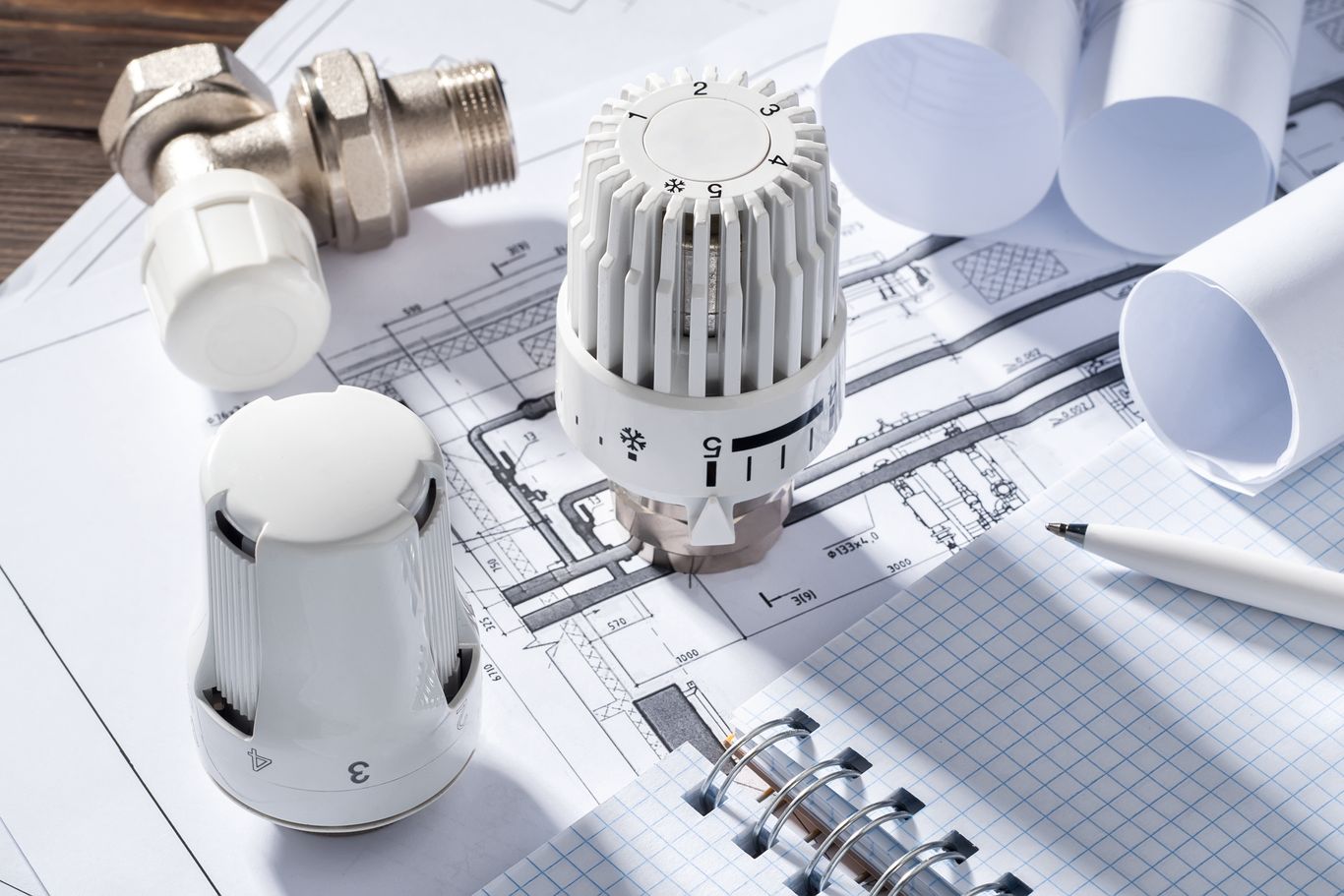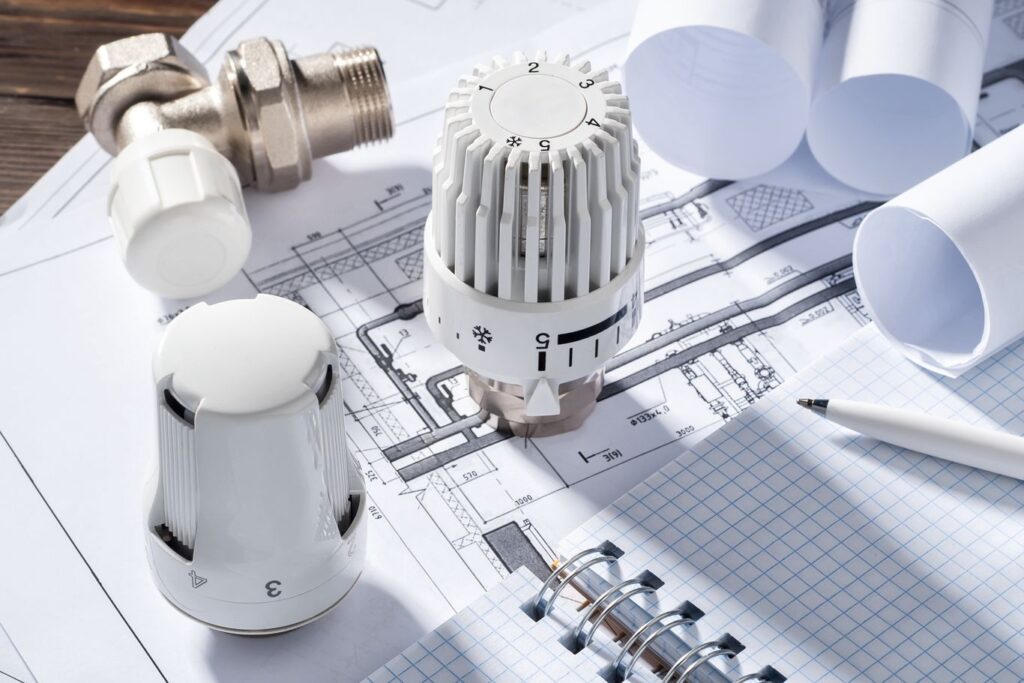L’amiante est un matériau qui a été largement utilisé au cours des dernières décennies dans de nombreux secteurs d’activité, dont la construction de voiries. Bien que celle-ci dispose de propriétés très intéressantes, son utilisation a été interdite depuis 1977 en raison de ses nombreux effets néfastes sur la santé.
L’amiante est encore très répandu dans les voiries et constitue un véritable risque pour les travailleurs. Pour répondre à cette problématique, la réglementation en vigueur impose la réalisation d’un diagnostic amiante avant le début de travaux de voirie.
Découvrez tout ce qu’il faut savoir sur le diagnostic amiante lors de travaux de voirie, de la réglementation en vigueur au déroulement d’un repérage avant travaux.
La réglementation amiante lors des travaux de voirie
L’utilisation de l’amiante est strictement interdite en France depuis 1997 selon le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996.
L’objectif de cette interdiction est d’assurer la protection de la population contre les risques liés à l’amiante, mais également celle des travailleurs sur chantier.
De nombreux ouvrages réalisés avant 1997 contiennent cependant de l’amiante. La loi El Khomri du 8 août 2016 impose le repérage de l’amiante avant travaux ou toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs à l’amiante.
Le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 intègre les travaux de voirie à la réglementation amiante
La réglementation relative aux risques d’exposition à l’amiante ne cesse de se renforcer depuis 2012. En 2016, l’article 113 de la loi n°2016-1088 a rendu obligatoire le repérage d’amiante avant n’importe quel type de travaux.
Les pouvoirs publics ont souhaité renforcer la réglementation amiante via le décret n°2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de l’amiante avant certaines opérations.
Celui-ci intègre le domaine d’application « Autres immeubles tels que terrains, ouvrages de génie civil et infrastructures de transport » qui concerne directement la voirie.
Ainsi, un repérage de l’amiante avant des travaux de voirie est obligatoire et concerne l’ensemble du réseau routier, à savoir :
- Les autoroutes,
- Les rues,
- Les pistes cyclables,
- Les routes nationales,
- Etc.
L’objectif est de permettre aux entreprises qui sont mandatées pour réaliser les travaux de voirie d’évaluer de manière précise les risques liés à l’amiante. Celles-ci sont ensuite en mesure de prévoir l’équipement de protection nécessaire à fournir à leurs salariés.
Qui est responsable du respect de la réglementation amiante lors de travaux de voirie ?
La personne responsable légalement de faire réaliser le repérage d’amiante dans le cadre de la préparation des travaux peut être : le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre ou le propriétaire.
Le repérage doit être réalisé avant le début du chantier et permet d’obtenir un document appelé RAT (Repérage Avant Travaux). Ce n’est qu’après la réception de ce document que le début des travaux de voirie peut être ordonné.
Le gestionnaire de voirie, quant à lui, a l’obligation de transmettre au maître d’ouvrage toutes les informations en sa possession concernant la présence d’amiante dans la zone concernée.
Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect de la réglementation amiante ?
Le non-respect de la réglementation amiante lors de travaux de voirie peut être sanctionné pénalement et civilement.
La loi El Khomri stipule qu’une amende administrative maximale de 9 000 € est prévue en cas de manquement avéré à l’obligation de détection de l’amiante avant travaux. Cette amende concerne les donneurs d’ordres, les propriétaires et les maîtres d’ouvrage.
Une sanction répressive (amende délictuelle de 3 750 €) est également prévue à l’encontre du donneur d’ordre en cas de manquement à l’obligation d’obtenir un RAT avant le début des travaux.
Notez que les personnes physiques risquent une peine d’emprisonnement et une amende pénale de 75 000 € en cas de récidive. Les personnes morales, quant à elles, risquent de perdre leur droit d’exercer.
Quelles sont les exemptions à l’obligation de repérage ?
Selon l’article R.4412-97-3 du Code du travail, le donneur d’ordre est exempté du repérage amiante avant travaux dans les cas suivants :
- Urgence liée à un sinistre présentant un risque grave pour la sécurité publique ou la protection de l’environnement,
- Urgence liée à un sinistre présentant des risques graves pour les biens et les personnes,
- L’opérateur de repérage juge qu’il s’expose à un risque excessif pour sa sécurité en réalisant le repérage (conditions techniques, circonstances exceptionnelles, etc.).
Les travailleurs doivent obligatoirement être protégés comme si la présence de l’amiante était avérée en cas d’exemption de repérage amiante.
L’importance du diagnostic amiante en voirie
Le diagnostic amiante en voirie est important en raison de plusieurs facteurs :
- Les effets particulièrement néfastes de l’amiante sur la santé des personnes exposées,
- L’utilisation importante d’amiante dans les enrobés bitumineux avant l’interdiction de 1997,
- La réutilisation et le recyclage des enrobés amiantés pour des travaux de voirie.
Quels sont les risques pour la santé en cas d’exposition à l’amiante ?
Les matériaux qui contiennent de l’amiante peuvent représenter un risque pour la santé des personnes lorsque ceux-ci sont en mauvais état ou manipulés lors de travaux (démolition, sciage, découpage, etc.).
Les fibres d’amiante libérées dans l’air sont extrêmement fines, imperceptibles à l’œil nu et très nocives.
Ces caractéristiques rendent les fibres d’amiante très facilement inhalables par les personnes qui y sont exposées. En cas d’inhalation, ces fibres cancérigènes pénètrent dans l’appareil respiratoire et peuvent causer un cancer pulmonaire.
D’autres pathologies, telles que l’asbestose ou la fibrose pulmonaire, peuvent également apparaître si la quantité de fibres retenues est importante.
Pourquoi retrouve-t-on de l’amiante dans les voiries ?
En raison de ses propriétés physiques et de son faible coût d’extraction, l’amiante a été largement utilisé par de nombreuses industries entre 1970 et 1995.
L’amiante a notamment été utilisé dans les enrobés bitumineux destinés à la formation des différentes couches des voiries afin de renforcer la résistance de certains tronçons.
Même si l’interdiction de l’usage de l’amiante en 1997 a permis de réduire les risques d’exposition, de nombreuses voiries contiennent encore de l’amiante. En outre, de nombreux enrobés contenant de l’amiante ont été recyclés ou réutilisés afin de limiter les déchets. Il est ainsi possible de retrouver de l’amiante dans des routes communales ou des trottoirs.
Pour réduire l’exposition de la population et des travailleurs sur voiries, la réglementation amiante a été mise en place et impose le repérage avant le début du chantier.
Le repérage HAP des enrobés routiers
Avant le début d’un chantier sur des voiries constituées d’enrobé, il est également nécessaire de réaliser un repérage des HAP (hydrocarbures aromatiques polycliques).
Les HAP ont principalement été utilisés dans les goudrons des liants jusqu’en 1993 afin d’optimiser l’adhérence et la résistance des enrobés. Ces composés sont nocifs pour la santé en cas d’inhalation de fumées provoquées par le réchauffage des liants.
Le donneur d’ordre doit prendre des dispositions particulières selon la teneur en HAP observée à la suite du repérage :
- Taux inférieur à 50 mg/kg : recyclage à froid ou à chaud,
- Taux entre 50 et 500 mg/kg : recyclage à froid uniquement,
- Taux supérieur à 500 mg/kg : recyclage strictement interdit et obligation de déposer les déchets dans une structure de stockage pour déchets dangereux.
Comment se déroule un diagnostic amiante pour les voiries ?
Voici les principales étapes réalisées par le diagnostiqueur, officiellement appelé opérateur de repérage, pour détecter la présence éventuelle d’amiante :
- L’élaboration d’un dossier qui reprend l’ensemble des informations techniques relatives à la voirie impliquée dans les travaux,
- La visite sur place afin de réaliser plusieurs prélèvements par carottage,
- L’envoi des prélèvements à un laboratoire d’analyse accrédité par le COFRAC,
- L’analyse du taux des HAP et la recherche d’amiante dans les prélèvements.
Les obligations que le diagnostiqueur doit respecter en matière de prélèvement dépendent principalement de la zone à couvrir et de l’envergure des travaux à réaliser. Celles-ci sont mentionnées dans la norme NF X 46-020.
En cas de présence d’amiante, le rapport de repérage doit stipuler les éléments suivants :
- La localisation exacte des prélèvements positifs,
- Les produits dangereux détectés et leur concentration,
- Les mesures de prévention à prendre avant de débuter les travaux,
- Les méthodes de retrait et d’élimination des éléments amiantés à respecter.
Si aucun produit dangereux n’est détecté, le donneur d’ordre reçoit le RAT et peut débuter les travaux.