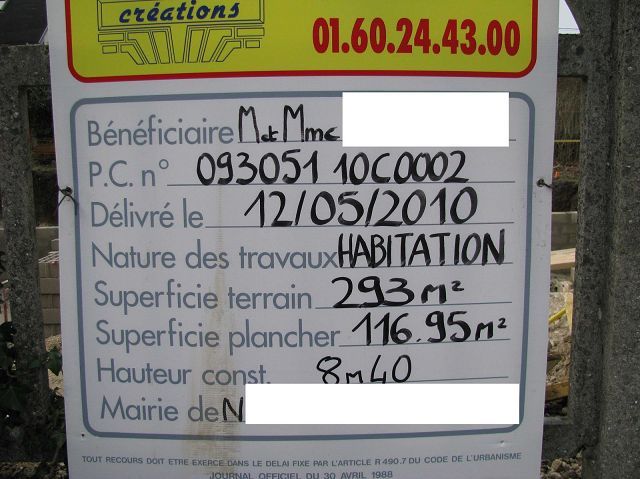Temps de lecture: 9 minutes
Le placo, ou plaque de plâtre, se retrouve depuis quelques années sur le podium des matériaux de construction les plus utilisés. Ce succès est dû à la facilité de pose du placo, à sa légèreté et à son prix peu onéreux. Cette méthode de finition est très souvent utilisée pour les murs, les plafonds ou encore les cloisons. Découvrez les différentes caractéristiques du placo et ses utilisations possibles.
Histoire du placo
Le placo, ou placoplatre, désigne une plaque de plâtre enfermée entre deux feuilles de carton lisse. Le placo est apparu en 1890 aux États-Unis et a ainsi permis de disposer d’un matériau de construction résistant au feu. Ce n’est qu’à la fin de la seconde guerre mondiale que l’on a vu apparaître les première plaques de plâtre en France.
Les industriels français étaient en effet à la recherche d’une solution adaptée à la reconstruction dans les bâtiments. En voyage aux États-Unis, ils ont découvert et importé ce matériau ingénieux et économique : voici le début de la société Placoplatre.
Si le placo désigne initialement la marque, ce terme est aujourd’hui entré dans le langage courant. Dans cet article, le terme “placo” désigne une plaque de plâtre, sans préférence de marque.
Les différents usages des plaques de plâtre
Le placo peut être posé sur toutes les surfaces intérieures, et a de ce fait de nombreux usages. Les plaques de plâtre peuvent en effet être utilisées pour les murs, les faux-plafonds, les plafonds, les murs rampants de combles aménagés, ou encore les cloisons.
Cloisons
Associées à des rails métalliques, les plaques de placoplatre permettent de cloisonner très rapidement un volume intérieur.
L’utilisation de placo pour réaliser le cloisonnement d’un espace permet d’optimiser les isolations thermiques et phoniques.
L’avantage des cloisons en placo est que la technique est sèche par rapport à une cloison réalisée en briques et en mortier.
Faux-plafond
La réalisation d’un faux-plafond est également une utilisation très courante des plaques de plâtre. Souvent utilisé de manière esthétique, le faux-plafond en placo peut être réalisé grâce à un réseau de rails métalliques fixé au plafond sur lesquels sont vissées les plaques de placo. Grâce à la légèreté du matériau, il est très facile de mettre en place de tels faux-plafonds.
Sachez qu’il est aujourd’hui très courant d’utiliser des plaques de plâtre pour réaliser des faux-plafonds décoratifs. Vous pouvez effectivement jouer avec des spots lumineux, des couleurs variées ou des volumes différents grâce à ce matériau et ainsi apporter une touche de modernité à votre intérieur.
Doublage
Le doublage en placoplâtre permet une bonne isolation et différentes finitions lorsqu’il est collé sur les matériaux de construction bruts (tels que des parpaings, des briques ou du bois) ou utilisé en rénovation sur des murs nécessitant de nombreuses reprises.
Avec une plaque de 10 mm d’épaisseur (le BA10 est parfait pour cette utilisation), comptez seulement 15 mm au total avec la colle pour obtenir une surface de mur intérieur impeccable.
Afin de réaliser le doublage d’un mur, il est tout à fait possible d’employer une variante qui est le double isolant.
Il existe en effet une multitude de produits combinant un isolant (par exemple en polystyrène, en polyuréthane ou encore en laine) d’épaisseurs variables (de 2 à 10 cm) et une plaque de placo. Ce doublage, une fois collé sur les murs bruts, en ménageant une lame d’air, permet d’isoler les murs par l’intérieur et de bénéficier d’un parement prêt à peindre et cela en un temps record.
Coffrages
Le placo est parfaitement adapté à la réalisation de coffrages, à la création d’ angles ou encore pour cacher certaines zones présentant des défauts.
Les plaques de plâtre présentent en effet l’avantage d’être bien plus légères et surtout moins onéreuses que des panneaux en bois. Comptez environ 2,50 €/m2 pour du placo contre 25 à 40 €/m2 pour des panneaux de MDF ou de contreplaqué.
En fonction de l’utilisation que vous comptez faire du placo, différents types de plaque de plâtre sont disponibles. Nous allons découvrir les différentes variétés de placo en fonction de leurs usages.
Les différents types de plaques de plâtre
Les plaques de placo possèdent des caractéristiques spécifiques concernant leur résistance à l’humidité, au feu ou encore en termes d’isolation.
Le placo classique
Il s’agit du placo standard qui convient à une grande partie des utilisations possibles. Ce type de placo est appelé BA 13, pour “plaque de plâtre à bords amincis de 13 mm d’épaisseur”.
Les bords amincis servent à noyer le joint interplaque sans que cela ne crée de surépaisseur.
On trouve également du BA 10, du BA 15, du BA 18 ou du BA 25. Ces placo sont identiques au BA 13, seule l’épaisseur diffère.
Ces plaques sont généralement de couleur grisâtre.
Le placo hydrofuge
Les plaques de plâtre hydrofuges sont idéales pour les pièces humides telles que la salle de bains, la cuisine ou encore le sous-sol. Ce type de placo est résistant aux moisissures et au pourrissement qui peuvent être fréquents dans les pièces très humides.
Ces plaques sont généralement de couleur verte.
Les plaques de plâtre ignifugées
Ce type de placo est résistant au feu grâce à un traitement ignifuge ralentissant la combustion de la plaque. La propagation d’un incendie se trouve donc fortement ralentie avec ce genre de placo.
Ce placoplâtre se retrouve fréquemment utilisé au sein des logements en bois, dans les espaces techniques ou encore pour la création de cloisons coupe-feu.
Ces plaques sont reconnaissables par leur couleur rouge ou rosée.
Le placo acoustique
Ces plaques sont très utiles pour réduire le bruit par leur meilleure isolation acoustique. Il s’agit de la solution idéale pour réaliser une cloison entre deux pièces ou pour la finition d’un mur qui se trouverait côté rue.
Ces plaques sont généralement de couleur bleue.
Côté prix, il existe une différence entre ces différents types de placo. Les plaques de plâtre classiques sont bon marché puisqu’il faut compter en moyenne 6 ou 7 euros par plaque. Le tarif des plaques spéciales est en revanche plus élevé. Comptez environ 20€ pour du placo acoustique ou ignifugé. Pour des plaques de plâtre hydrofuges, il faut compter en moyenne 18€ par plaque.
Avantages et inconvénients du placo
Les plaques de plâtre sont devenues très populaires en construction. Toutefois, le placo présente certaines limites.
Découvrez les avantages et les inconvénients des plaques de plâtre dans le tableau suivant :
| Avantages |
Inconvénients |
- Gain de temps puisque la pose de placo est relativement rapide,
- Économique,
- Le placo offre un revêtement peu encombrant par rapport à des murs “classiques”,
- Facile à décorer.
|
- Peu durable car la résistance du placo n’est pas très élevée,
- Mauvaise résistance à l’eau (à moins d’utiliser du placo hydrofuge),
- Réparation difficile si les dégâts sont conséquents.
|
Matériel nécessaire à la pose de placo
Pour poser des plaques de plâtre correctement, certains outils sont indispensables et en fonction de ce que vous souhaitez faire, nombre d’accessoires peuvent être utiles.
Découvrons le matériel principal et indispensable.
Rails à placo et montants
Il s’agit ici d’une partie métallique qui se dispose en pied et en tête de cloison. Ces rails, utilisés avec des montants, vont permettre de créer une structure métallique sur laquelle seront vissées les plaques de plâtre afin de réaliser des cloisons ou des plafonds autoportants.
Les rails sont dénommés, selon les fabricants, R48 ou R70 selon que la largeur des rails soit de 48 ou 70 mm. La largeur du rail est définie en fonction de l’épaisseur d’isolation souhaitée.
Fourrures et suspentes
Les fourrures sont équivalentes aux rails puisqu’elles servent à construire la structure métallique sur laquelle est vissée le placoplâtre. La différence vient du fait que les fourrures s’utilisent avec des suspentes afin de créer un plafond suspendu ou rampant.
Les suspentes permettent de fixer les fourrures au bâti.
Lève-plaques
Cet outil est très utile afin de séparer les plaques et de les lever en hauteur lors de la réalisation de faux-plafonds. Un lève-plaques peut être loué pour un montant d’environ 30 € par jour.
Notez que le lève-plaques n’est pas nécessaire pour la réalisation de cloisons.
Mortier adhésif pour placoplâtre
Également appelé MAP, le mortier adhésif est une colle servant à coller du placo ou des doublages isolants. Le support en placo doit être propre et sain avant l’application du mortier adhésif, pour que l’adhérence soit optimale. Le MAP nécessite en moyenne une durée de deux heures pour sécher convenablement.
Cette colle est conditionnée en sac, sous forme de poudre qu’il convient de mélanger à de l’eau.
Notez que le MAP est un type de pose de placo. La pose la plus fréquente reste la fixation des plaques de plâtre sur une ossature métallique à l’aide de vis.
Enduit et bandes de jointure
La jonction des plaques de plâtre lors d’une construction est réalisée grâce à la pose de bande à joints qui seront ensuite recouvertes d’enduit. Le fait de jointer les plaques entre elles apporte, en plus de l’esthétisme, de la solidité à votre cloison.
Pour réaliser vos bandes à joint, il convient de remplir le joint entre deux plaques d’enduit, puis de le recouvrir avec la bande à joint. Une fois l’ensemble sec, généralement le lendemain, il est nécessaire de recouvrir l’enduit une nouvelle fois.
Cette liste est non-exhaustive et il est évident que des outils de mesures et de découpe vous seront nécessaires.
La pose de placo en 5 étapes
1. Préparation du chantier
La première étape est nécessairement la préparation du chantier avec la prise de côtes suivie du traçage du plan sur les murs, au sol et au plafond. Cela évitera bien des erreurs. L’emplacement des rails ou des fourrures doit également être marqué.
2. Mise en place de l’ossature métallique
Une fois les rails et montants coupés aux bonnes dimensions grâce à une cisaille à tôle, il convient de les assembler et de les visser au plafond et au sol.
L’assemblage des montants assure la jonction verticale. Ces derniers s’insèrent facilement dans les rails et plus l’entraxe est réduit entre les deux, plus la cloison sera rigide.
3. Installation des plaques de plâtre
Les plaques de placo vont pouvoir être fixées sur l’ossature métallique grâce à des vis et à un porte-embout spécial placo qui permet de régler la profondeur du vissage. Pour plus de solidité, il est important de mettre suffisamment de vis (il est fréquent d’en compter une bonne vingtaine par plaque) et de les répartir équitablement.
Dans le cas d’une cloison, n’oubliez pas d’installer votre isolant phonique ou thermique ainsi que les gaines électriques avant d’habiller l’autre côté de la cloison avec des plaques de plâtre.
4. Réalisation des joints
Afin d’éviter toute fissure et pour davantage d’esthétisme, il convient de mettre de l’enduit sur les joints et d’apposer le calicot papier (la bande de jointure). Une fois sec, en général après 24 heures, recouvrir la totalité des bandes de joint d’enduit, et les lisser pour un résultat parfaitement plan.
5. Finitions
Il n’existe ici pas de règle puisque la décoration est une affaire personnelle. Selon vos choix, le placo peut être peint ou recouvert de papier peint.
Astuces lors de la pose de placo
- Joints : cette opération étant assez délicate, il convient de la réaliser avec soin. Il est préférable d’utiliser de l’enduit spécial pour joint et de ne pas hésiter à en mettre suffisamment pour la première couche avant la pose du calicot de papier. Une seconde astuce consiste à mouiller les bandes avant la pose, ce qui permet d’éviter les cloques par la suite.
- Protection des pieds de plaques : au moment de poser les plaques sur l’ossature de la cloison, il convient d’utiliser une chute contre le rail en pied afin de surélever les plaques d’environ un centimètre pour les protéger de l’humidité. Cela est particulièrement utile dans les pièces humides.
- Protection des rails en pieds : Dans les pièces humides, il est nécessaire de protéger le rail en pied de cloison avec un “U” en plastique ou un film plastique.
- Vissage : attention à ne pas visser trop fort le placo sur l’ossature métallique. En règle générale, la tête de vis doit tout juste affleurer la face cartonnée.
- Ne pas fixer le placo sans ossature métallique/bois : la pose de placo pour réaliser des cloisons, coffrages et faux-plafonds se réalise toujours sur une ossature (le plus souvent métallique). C’est cette ossature qui va empêcher les fissures puisqu’elle absorbe les déformations du support, la dilatation ou les vibrations. Le seul cas où du placo est posé sans ossature est une application en doublage, c’est-à-dire pour servir d’isolation en étant posé directement sur les murs bruts de la maison.
- Montage des cloisons « double peau » : afin d’améliorer les propriétés thermo-acoustiques d’une cloison placo, il est possible de poser deux plaques de chaque côté de l’ossature métallique au lieu d’une. Cela s’appelle alors une cloison « double peau ». Pour en tirer tous les bénéfices, il est important de décaler la deuxième couche de placo pour qu’elle recouvre les joints de la première couche, autrement dit, de poser les plaques de plâtre en quinconce.
Pour construire aux normes : le DTU 25.41
Dans la construction de bâtiments, il existe des règles de l’art (textes législatifs et techniques de référence). Tout cela est regroupé dans les Documents Techniques Unifiés (DTU) qui constituent des ouvrages de référence.
Consulter le DTU vous permettra de connaître les normes à respecter avant de vous lancer dans votre pose de placo.
Vous trouverez les dispositions à mettre en œuvre pour l’ossature, les joints et les recouvrements dans le DTU 25.41.
Questions fréquentes sur la construction en placo
Existe-t-il différentes sortes de placo ? Oui, en plus du placo classique il existe des plaques de plâtre ayant des caractéristiques différentes : traitement hydrofuge, traitement ignifuge ou encore du placo avec une meilleure isolation acoustique.
Un lève-plaque est-il nécessaire pour réaliser des constructions en placo ? Cela dépend : pour la réalisation de faux-plafonds il est fortement recommandé d’utiliser un lève-plaques. En revanche, ce dernier n’est pas nécessaire pour la réalisation de cloisons en placo.